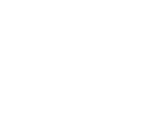Lieu unique de réflexion
Lieu unique de réflexionLe Groupement Français de l’Industrie de l’Information (gf2i) est un lieu unique de réflexion, d’échanges et d’expertise sur la nouvelle économie de la connaissance et de la donnée.
Depuis plus de 40 ans, notre association réunit des professionnels issus des secteurs publics et privés : chercheurs, représentants de l’administration, chefs d’entreprise, ingénieurs, experts de la data ou du marketing, consultants, professionnels libéraux…
Notre ambition commune est de faire émerger des solutions opérationnelles répondant aux impératifs de nos membres, attachés à relever pleinement et durablement les défis de la transition numérique et écologique.
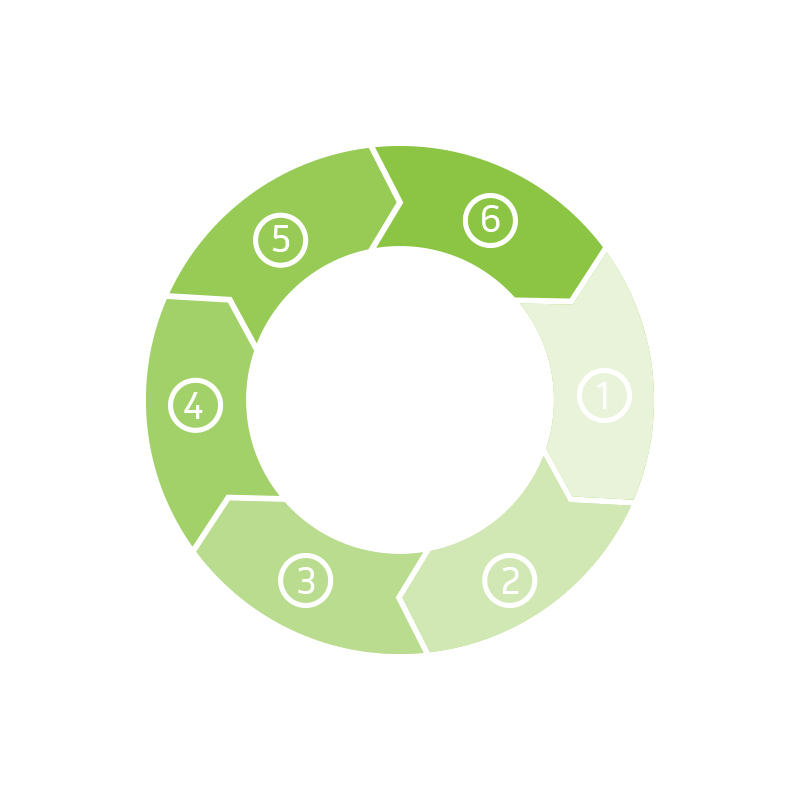
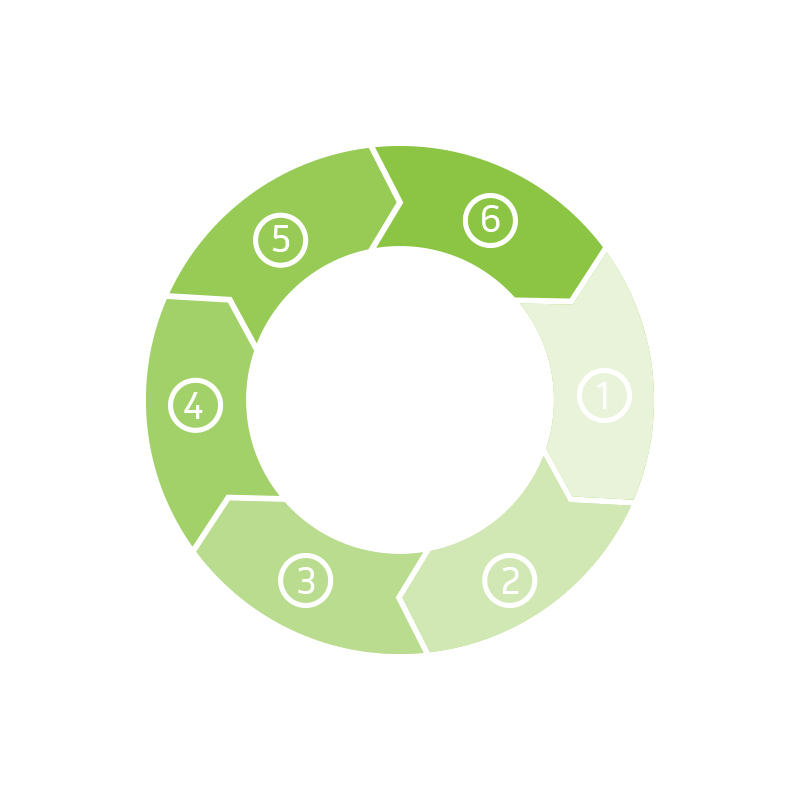
Adhérer au gf2i
Groupe Open Science
Dans un contexte d’accélération et de diversification de la réflexion sur l’avenir de la publication scientifique, d’émergence d’un grand nombre de nouveaux acteurs et services au sein de l’écosystème de l’édition scientifique et d’absence d’un espace de dialogue rassemblant acteurs privés de la science ouverte (anciens ou nouveaux) et acteurs publics, la constitution de ce groupe d’experts a pour objectif d’échanger sur les enjeux et défis de la science ouverte.
Ses animateurs sont Thomas Parisot (Cairn.info) et Yann Mahé (MyScienceWork) ».
 EN SAVOIR PLUS
EN SAVOIR PLUS
Groupe Intelligence Artificielle
L’atelier Intelligence Artificielle entend « désambiguïser » le sujet de l’IA, aujourd’hui présente à toutes les étapes du cycle de l’information.
Ses animateurs sont Christian Langevin (Qwam Content Intelligence), Christine Sempé (Elsevier) et Antoine Raulin (Bureau van Dijk Information Management).
 EN SAVOIR PLUS
EN SAVOIR PLUS
Groupe Ouverture et Valorisation des Données publiques et privées
L’atelier Ouverture et Valorisation des Données publiques et privées est consacré à l’ouverture et à la réutilisation des données publiques et privées, tant au niveau français qu’européen. Il s’intéresse également aux modèles de valorisation des données, ainsi qu’à l’éventuelle rémunération des producteurs des données, sans oublier les modalités de suivi et de contrôle des interactions avec les ré-utilisateurs.
Ses animateurs sont Denis Berthault (LexisNexis) et Frédéric Cantat (IGN – Institut national de l’information géographique et forestière) et Olivier Delteil (DINUM).
 EN SAVOIR PLUS
EN SAVOIR PLUS